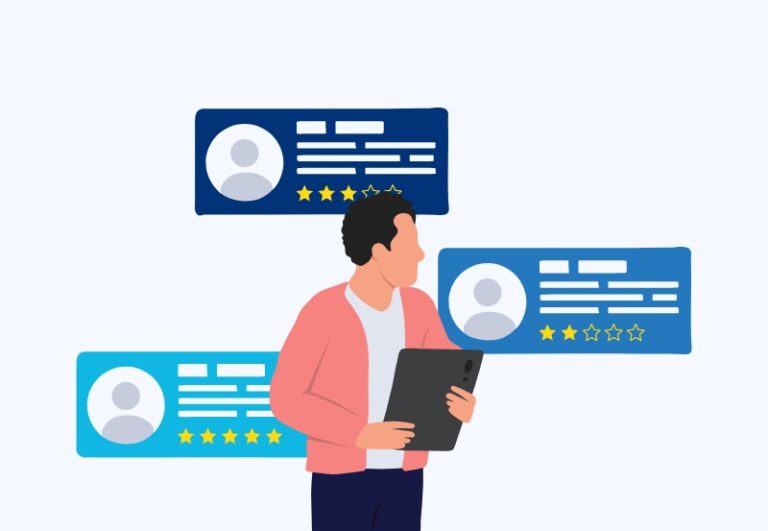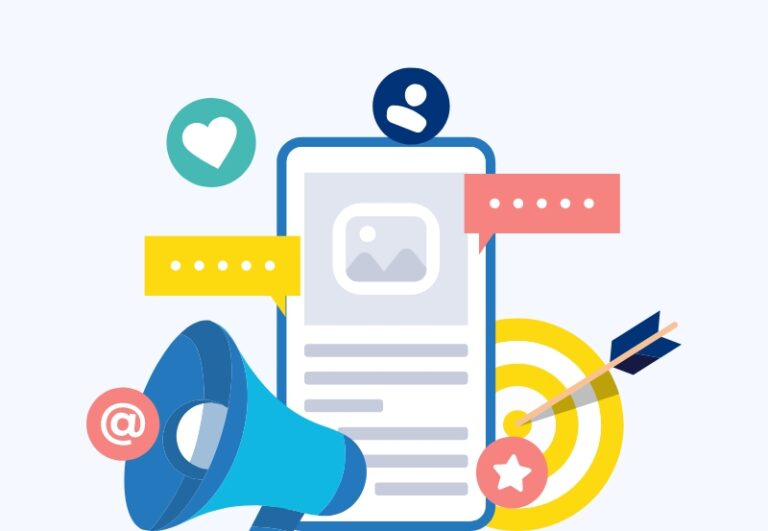La France doit transposer la directive européenne 2023/970 sur la transparence salariale avant le 7 juin 2026. Fourchettes de salaires dans les offres, droit d’accès à la rémunération moyenne, plan d’action si l’écart dépasse 5 %… la transparence des salaires devient une obligation légale.
Mieux vaut donc s’y préparer dès maintenant, non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité d’équité, de confiance et d’attractivité.
Transparence salariale : définition et enjeux RH
Qu’est-ce que la transparence salariale ?
La transparence salariale correspond au partage d’informations liées aux rémunérations dans une organisation.
L’objectif est de rendre plus lisibles les niveaux de salaire, les critères qui les déterminent et les écarts éventuels entre salariés occupant des postes comparables.
Transparence ne signifie pas équité
Transparence et équité n’ont pas la même portée. En effet, rendre les salaires visibles ne garantit pas qu’ils soient justes. La transparence permet d’identifier les écarts, quant à l’équité, elle consiste à les corriger.
Pour cela, les entreprises doivent s’appuyer sur des critères objectifs :
- les compétences requises pour le poste ;
- les responsabilités exercées ;
- la performance ;
- ou encore l’ancienneté.
Une communication salariale claire n’a de sens que si elle repose sur une évaluation structurée et cohérente.
Le cas échéant, de la défiance et des tensions internes peuvent naître.
Que dit la directive européenne sur la transparence des rémunérations ?
Les grandes étapes de mise en œuvre
Adoptée le 10 mai 2023, la directive (UE) 2023/970 vise à renforcer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Chaque État membre doit la transposer dans son droit national avant le 7 juin 2026.
En France, un projet de loi était attendu à l’automne 2025, mais le calendrier politique a pris du retard. Mais, les obligations européennes s’imposeront quelles que soient les évolutions gouvernementales.
Cette directive complète les outils déjà existants, comme l’Index égalité professionnelle, mais va plus loin sur plusieurs points :
- elle renforce la collecte et la communication des données salariales ;
- elle élargit les obligations de transparence aux phases de recrutement ;
- et elle introduit de nouveaux droits pour les salariés.
Ce que la directive impose aux entreprises
La directive fixe des obligations concrètes, applicables progressivement selon la taille des structures.
La transparence dès le recrutement
Les entreprises devront indiquer, dès la publication d’une offre d’emploi, le salaire ou la fourchette de rémunération correspondant au poste proposé. C’est également une action simple qui met en confiance la nouvelle recrue lors de son onboarding.
Les entreprises ne pourront par ailleurs plus demander au candidat la rémunération perçue dans son emploi précédent.
Le droit d’accès à l’information pour les salariés
Chaque salarié pourra obtenir :
- son niveau de rémunération individuel ;
- et la rémunération moyenne des salariés exerçant un travail de valeur égale, ventilée par sexe.
L’employeur aura alors deux mois pour répondre à la demande.
La publication obligatoire pour certaines entreprises
Les entreprises de plus de 100 salariés devront publier régulièrement un rapport sur les écarts de rémunération femmes-hommes.
Si un écart moyen supérieur à 5 % est constaté sans justification objective, elles disposeront de six mois pour corriger la situation. À défaut, une évaluation conjointe devra être menée avec les représentants du personnel.
Révision des classifications
Pour comparer les postes de “valeur égale”, les entreprises devront s’appuyer sur des critères harmonisés : compétences, responsabilités, effort, conditions de travail. Cela suppose une refonte des grilles et des référentiels de fonctions.
Sanctions et contrôle
Le texte introduit un principe fort : le renversement de la charge de la preuve. En cas de litige, c’est désormais à l’employeur de démontrer que la différence de rémunération n’est pas discriminatoire.
Les États membres devront prévoir des sanctions financières proportionnées et garantir la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié. Les indemnisations ne seront plus plafonnées.
Pour les employeurs, cela veut dire qu’il est nécessaire :
- de documenter chaque décision salariale ;
- de justifier les écarts à l’aide de critères précis et traçables ;
- et de mettre à jour les données de rémunération dans les SIRH ou logiciels de paie.
La directive crée donc une obligation de résultat, et non plus seulement de moyens.
👍 La transparence salariale nécessite de repenser de nombreux éléments de votre gestion RH. Nibelis, c’est la solution paie et RH complète pensée pour vous simplifier le quotidien : réservez votre démo.
Préparer son entreprise à la transparence salariale
Attendre 2026 serait une erreur : mieux vaut engager dès maintenant une démarche structurée.
1️⃣ Construire une grille de rémunération claire
La première étape consiste à cartographier les postes et à définir des critères de rémunération précis. Chaque fonction doit être évaluée selon des paramètres objectifs
- les compétences requises ;
- les responsabilités ;
- les conditions de travail ;
- l’ancienneté ou l’expérience.
Sur cette base, l’entreprise peut établir des fourchettes salariales cohérentes et comparables d’un service à l’autre.
2️⃣ Former les managers
Les managers seront les premiers sollicités lorsque la transparence deviendra effective.
Ils doivent comprendre la logique de la directive et savoir expliquer les critères de rémunération sans maladresse ni imprécision.
La formation doit couvrir :
- la lecture et l’explication de la grille de salaires ;
- les arguments à utiliser face aux comparaisons internes ;
- la posture à adopter pour éviter les tensions.
Un manager formé peut répondre aux interrogations avec assurance et renforcer la confiance de son équipe.
3️⃣ Communiquer avec cohérence et pédagogie
Il n’existe pas une seule manière d’appliquer la transparence salariale.
Certaines entreprises choisiront une transparence totale : salaires nominaux accessibles à tous. D’autres opteront pour une transparence graduée : publication de fourchettes et explication des critères.
Le choix dépend de la culture d’entreprise, mais la cohérence reste essentielle pour préserver la marque employeur : le message transmis à l’interne doit correspondre à celui publié dans les offres d’emploi ou sur le site carrière.
FAQ - L’essentiel à retenir sur la transparence salariale
Qu’est-ce que la transparence salariale ?
La transparence salariale consiste à partager les niveaux et critères de rémunération au sein d’une entreprise. Elle vise à garantir une information claire pour les salariés et à prévenir les écarts injustifiés entre postes équivalents.
Que prévoit la directive européenne 2023/970 sur la transparence des rémunérations ?
Elle impose aux entreprises, d’ici juin 2026, d’indiquer la rémunération dans les offres d’emploi, de publier les écarts femmes-hommes et de corriger tout écart supérieur à 5 % non justifié.
Comment communiquer sur la transparence salariale en interne ?
Chaque entreprise peut choisir son approche :
- la transparence totale (salaires nominaux accessibles) ;
- ou la transparence graduée (fourchettes et critères).
L’essentiel est de garantir un discours cohérent et de former les managers à répondre aux questions sur la rémunération.
Est-ce que publier les salaires dans les offres d’emploi attire plus de candidats ?
Oui. En France, selon les données Indeed Hiring Lab (2025)¹, une annonce sur deux (50,7 %) mentionne aujourd’hui un salaire, un taux en nette hausse ces dernières années. En outre, la transparence salariale inspire confiance et permet sans aucun doute d’améliorer la qualité de l’expérience candidat.
Que faire si la transparence met en évidence des écarts de rémunération ?
L’entreprise doit analyser les données, identifier les causes et élaborer un plan d’action correctif. Cette démarche permet de prouver la conformité et d’améliorer l’équité interne.