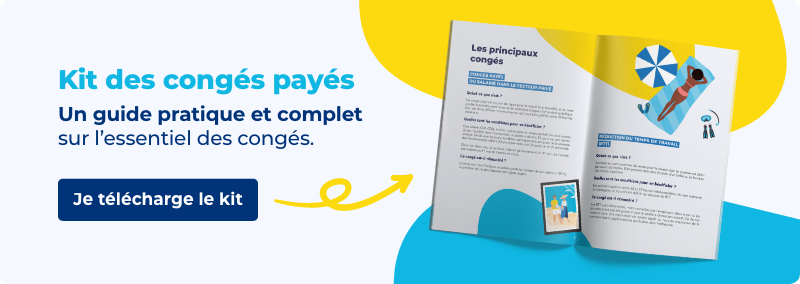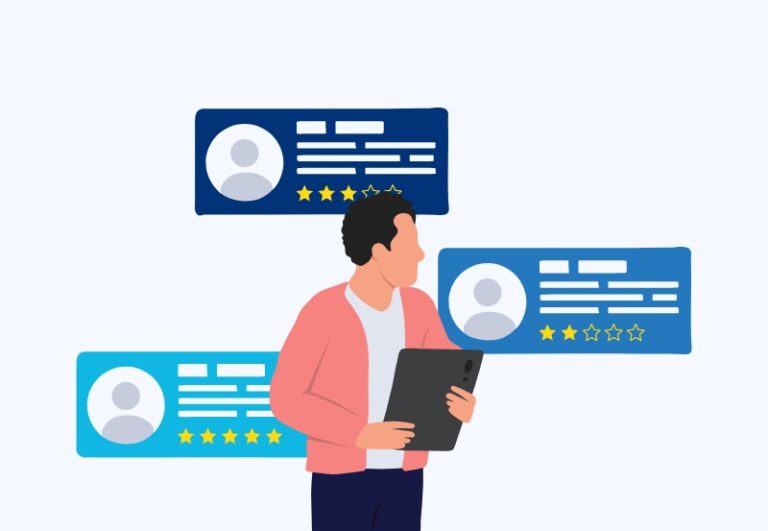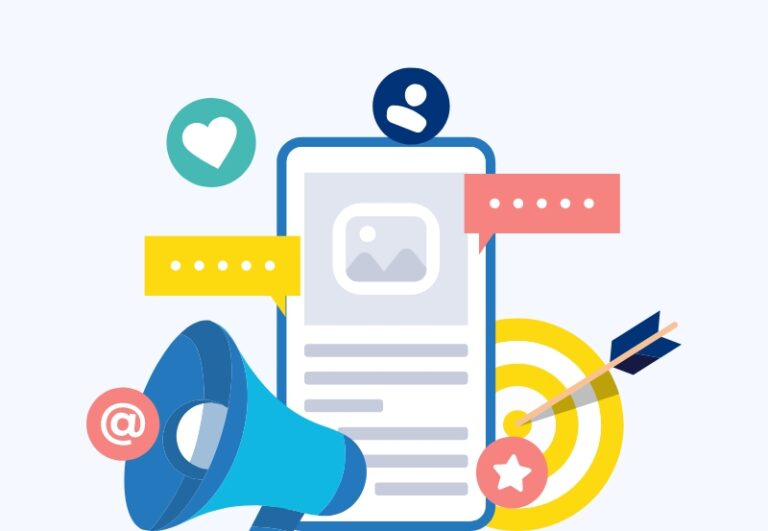En 2024, près de 5 % des jours travaillés en France ont été perdus à cause de l’absentéisme. Quant aux arrêts de travail, ils durent en moyenne près de trois semaines (Source : Étude Diot-Siaci x IPSOS, 2025). Mais, derrière ces chiffres, ce sont donc bien plus que de simples rhumes hivernaux qui se cachent : surcharge de travail, tensions internes, manque de reconnaissance… autant de signaux qui fragilisent les équipes, désorganisent le quotidien et affectent la santé financière de l’entreprise.
Que recouvre réellement l’absentéisme au travail ? Quelles en sont les causes, visibles mais aussi invisibles ? Quel impact concret sur vos équipes et vos résultats ? Et surtout, comment agir avant que l’absentéisme ne s’installe durablement ?
L’absentéisme au travail : de quoi parle-t-on ?
Une absence n’est pas toujours de l’absentéisme
L’absentéisme désigne les absences imprévues d’un salarié pendant ses jours habituels de travail. Contrairement aux congés payés, RTT ou formations, elles ne sont pas planifiées et peuvent perturber l’organisation de l’équipe.
Mais, toutes les absences imprévues ne sont pas forcément considérées comme de l’absentéisme au sens strict.
Une réalité aux visages multiples
L’absentéisme est à la fois un mélange de raisons médicales, personnelles… et parfois organisationnelles.
Selon la Dares, les absences liées à la maladie de courte durée (moins de 8 jours) représentent près de 6 absences sur 10. Ce sont aussi les plus susceptibles de se répéter, surtout chez les salariés exposés à une charge de travail élevée ou un climat de travail difficile.
C’est ce qu’on appelle l’absentéisme perlé : une succession d’arrêts courts, parfois espacés de quelques jours, dont l’effet cumulé finit par peser lourd sur le fonctionnement de l’équipe. Ce phénomène, souvent discret, peut aussi être le signe d’un climat social fragilisé.
Quelles sont les causes de l’absentéisme au travail ?
Les facteurs individuels
Certaines absences sont directement liées à l’état de santé ou à la situation personnelle des salariés. Fatigue, douleurs physiques, maladies saisonnières ou chroniques : ces motifs, parfois inévitables, peuvent aussi traduire un besoin de repos face à une charge importante.
L’âge, les antécédents médicaux ou encore des contraintes familiales peuvent aussi contraindre à un arrêt de travail prolongé.
Les facteurs organisationnels
Le manque de reconnaissance, les relations dégradées ou le sentiment d’injustice favorisent aussi le désengagement et le sentiment de stress. Dans ce contexte, l’absence devient parfois un moyen de relâcher la pression…
Quelles sont les conséquences de l’absentéisme au travail ?
Une organisation qui doit s’adapter en urgence
Lorsqu’un salarié manque à l’appel, il faut souvent :
- réorganiser les plannings,
- répartir les tâches différemment
- ou repousser certains projets.
Dans les petites équipes, cet effet se ressent immédiatement et ralentit l’activité. Et plus l’absence se prolonge, plus il devient difficile d’assurer la continuité du service.
Une pression accrue sur les collègues
Pour compenser, les équipes présentes doivent souvent fournir un effort supplémentaire. Selon la Dares, dans près d’un tiers des cas, cela signifie “travailler plus vite” pour absorber la charge laissée par l’absence. Un rythme de travail qui s’intensifie se traduit par davantage de stress, de fatigue et parfois de nouvelles absences.
Des coûts qui dépassent la seule paie
Le budget alloué aux dépenses de santé en France atteindra près de 260 milliards d’euros en 2025.
Chaque arrêt de travail y contribue, notamment par le coût des indemnités journalières. Cette hausse se répercute indirectement sur les entreprises via les cotisations et le financement du système de santé.
In fine, l’absentéisme coûte deux fois plus à l’entreprise. D’abord en interne, par la désorganisation et la perte de productivité. Ensuite, via un système de santé sous tension… auquel elle contribue directement.
Quelles solutions pour réduire l’absentéisme au travail ?
Les règles à garder à l’esprit
Réduire l’absentéisme passe aussi par le fait de bien connaître les règles et évolutions qui l’encadrent. En 2025, plusieurs dispositions viennent préciser ou renforcer la manière dont les absences doivent être gérées :
- L’abandon de poste : depuis fin 2022, un abandon prolongé entraîne une présomption de démission, avec perte des droits au chômage,
- Le passeport de prévention : en cours de généralisation, il centralise toutes les attestations de formation liées à la santé et à la sécurité au travail. Cela permettra aussi de faciliter le suivi légal,
- La prévention des fortes chaleurs : depuis mai 2025, des mesures spécifiques doivent être mises en place pour protéger les salariés lors des épisodes de chaleur intense, avec des seuils fixés par Météo-France.
Agir sur l’organisation du travail
Réduire la charge excessive, clarifier les priorités et donner plus de marge de manœuvre aux équipes est important pour limiter l’usure professionnelle.
Voici quelques pistes à explorer :
- Revoir la répartition des tâches pour éviter les surcharges ponctuelles,
- Prévenir les troubles musculosquelettiques par des aménagements adaptés,
- Mettre en place un suivi régulier de la charge de travail réelle,
- Encourager le fractionnement des congés payés.
Limiter la fatigue mentale en soutenant le droit à la déconnexion
Répondre à un email tard le soir, consulter ses notifications le week-end… Ces habitudes, en apparence anodines, entretiennent une hyperconnexion qui épuise sur la durée.
Le droit à la déconnexion, inscrit dans le Code du travail depuis 2017, permet de fixer des limites claires pour préserver les temps de repos et éviter que la charge mentale ne déborde sur la vie personnelle.
Concrètement, l’entreprise peut :
- définir des plages de non-sollicitation (par exemple, pas d’emails après 19 h),
- sensibiliser les managers au respect de ces règles,
- proposer aux équipes de désactiver les notifications en dehors des horaires de travail.
Réduire l’absentéisme avec la solution GTA Nibelis
Un outil GTA devient un véritable levier de prévention de l’absentéisme, il permet notamment de :
– suivre en temps réel les absences, retards et présences, afin de détecter plus rapidement les signaux faibles ;
– offrir une vision fine de la charge de travail, ce qui aide à rééquilibrer les plannings et à éviter la surcharge qui mène souvent à l’épuisement ;
– favoriser la transparence et l’équité, en rendant les règles de gestion claires pour tous et en limitant le sentiment d’injustice, souvent source de désengagement.
La réduction de l’absentéisme, c’est d’abord un suivi plus simple et plus fiable ! Réservez votre démo sans plus attendre.
FAQ — Absentéisme au travail
Que dit la législation 2025 sur l’absentéisme au travail ?
Comment calculer le taux d’absentéisme au travail ?
Le taux d’absentéisme se calcule en rapportant le nombre total de jours d’absence (hors congés et formations) au nombre de jours théoriquement travaillés sur la période.
Par exemple : si votre équipe totalise 50 jours d’absence sur 1 000 jours travaillés, le taux est de 5 %.
Faut-il différencier les absences justifiées et injustifiées dans le taux d’absentéisme ?
Quelles sont les principales causes de l’absentéisme au travail ?
Les arrêts de travail sont souvent liés à des problèmes de santé (fatigue, maladies saisonnières, troubles musculosquelettiques), mais aussi à des causes organisationnelles comme la surcharge de travail, le manque de reconnaissance ou un climat social dégradé.
Comment réduire l’absentéisme en entreprise ?
- Adapter l’organisation du travail pour limiter la surcharge,
- Former les managers à la prévention des risques psychosociaux,
- Mettre en place un suivi précis des absences grâce à une solution de Gestion des Temps et des Activités (GTA) comme Nibelis.