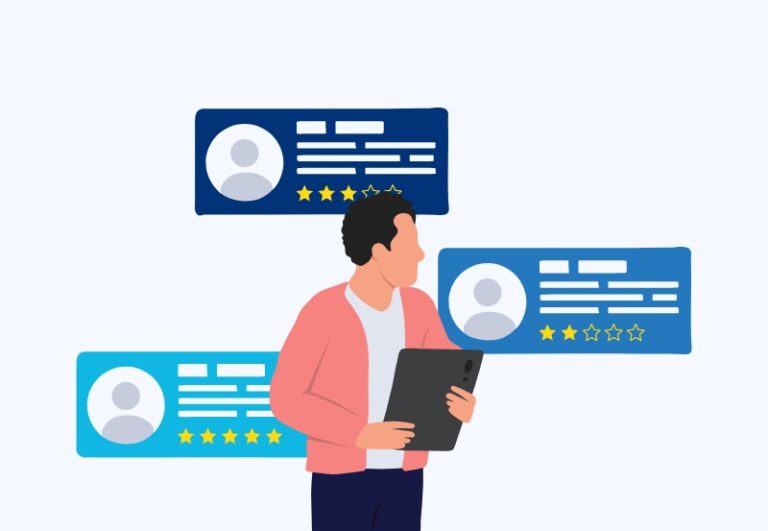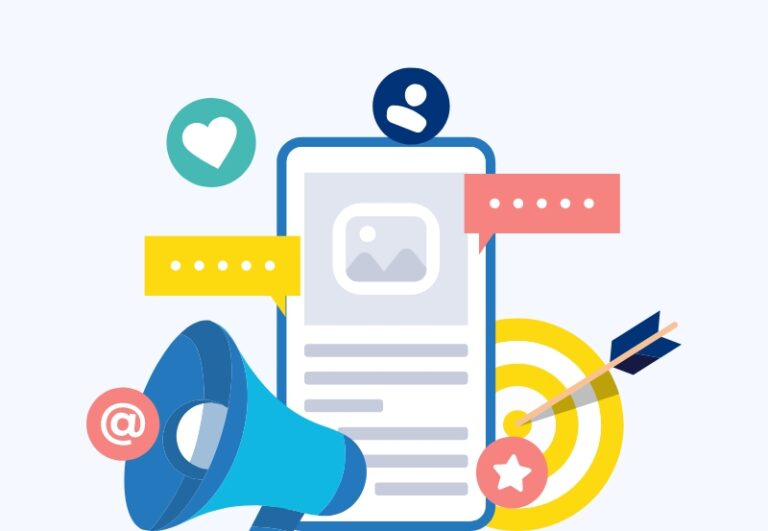Notifications, emails, appels Teams… Même en vacances, difficile de vraiment couper. Alors que l’été bat son plein, la question du droit à la déconnexion revient sur le devant de la scène. Ce droit, inscrit dans la loi depuis 2017, peine encore à s’imposer dans les pratiques professionnelles. Pourtant, il est devenu essentiel en 2025 pour préserver la santé mentale des salarié·es… et la performance des entreprises.
- Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?
- Pourquoi est-ce crucial en 2025 ?
- Que dit la loi sur le droit à la déconnexion ?
- Comment les entreprises appliquent ce droit ?
- Comment encourager (vraiment) vos salariés à la déconnexion pendant leurs congés ?
- Un droit à faire vivre… grâce à une meilleure organisation du temps
Qu'est-ce que le droit à la déconnexion ?
Le droit à la déconnexion est un principe inscrit dans le Code du travail depuis la loi Travail du 8 août 2016, en vigueur depuis janvier 2017. Il permet à tout salarié de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail, notamment via les outils numériques professionnels et personnels (emails, messagerie instantanée, appels…).
L’objectif est clair : protéger les temps de repos, garantir un équilibre vie professionnelle / vie personnelle, et prévenir les risques psychosociaux comme l’épuisement professionnel.
Ce droit n’est pas un gadget : il s’inscrit dans une démarche de qualité de vie au travail (QVCT) et de performance durable.
Pourquoi est-ce crucial en 2025 ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon le Cahier des tendances RH 2025 (Parlons RH) :
- 30 % des salarié·es sont concernés par l’hyperconnexion
- 78 % des cadres ne se déconnectent pas le week-end ni pendant les vacances
Les conséquences de cette hyperconnexion sont préoccupantes : elle perturbe le sommeil, favorise une fatigue chronique, peut entraîner des comportements addictifs liés au numérique et accentue le sentiment d’isolement, en particulier chez les salarié·es les plus fragiles. Ces effets ne s’arrêtent pas aux frontières de la sphère privée : ils impactent directement l’entreprise, en provoquant une baisse d’efficacité, un désengagement progressif et un turnover plus élevé.
En 2025, avec la généralisation du télétravail et la multiplication des outils collaboratifs, il devient essentiel de poser des limites claires pour préserver l’équilibre et la performance au travail.
Que dit la loi sur le droit à la déconnexion ?
Depuis 2017, la loi impose aux entreprises de plus de 50 salarié·es de mettre en place des modalités de régulation des outils numériques. Concrètement, si un accord collectif est signé, il fixe ces modalités dans le cadre de la négociation annuelle sur la QVCT. À défaut, l’employeur doit rédiger une charte définissant les conditions d’exercice du droit à la déconnexion. L’objectif est de formaliser les règles, pour éviter que la charge mentale ne s’infiltre dans les temps de repos. C’est un enjeu RH stratégique, à la croisée des problématiques de bien-être, de management et de productivité.
Comment les entreprises appliquent ce droit ?
Afin de faire appliquer ce droit, les entreprises peuvent mettre en place des actions concrètes pour faire vivre ce droit au quotidien :
- Définir des plages de non-sollicitation (exemple : pas d’emails entre 19h et 8h)
- Insérer des messages dans les signatures mail pour normaliser le respect des horaires (« Je vous écris en dehors des heures de travail, ne vous sentez pas obligé·e de répondre immédiatement »)
- Désactiver les serveurs ou outils collaboratifs le soir ou le week-end
- Former les équipes à une meilleure gestion du numérique
Ce sont souvent de petites actions, mais elles contribuent à instaurer une culture plus saine et plus respectueuse des temps de chacun.
Comment encourager (vraiment) vos salariés à la déconnexion pendant leurs congés ?
La période estivale est un bon indicateur du respect (ou non) du droit à la déconnexion. Pour que vos collaborateurs puissent réellement décrocher pendant leurs vacances, quelques bonnes pratiques sont à encourager :
✅ Invitez vos équipes à programmer une réponse automatique indiquant la date de retour et les coordonnées d’un relais.
✅ Anticipez en amont les absences pour répartir ou déléguer les tâches critiques.
✅ Encouragez la désactivation des notifications (ou même la suppression temporaire des applis pro).
✅ Fixez des règles de non-sollicitation claires, partagées à l’équipe avant le départ.
✅ Rappelez qu’une vraie coupure améliore la performance à long terme, ce n’est ni un luxe, ni un désengagement.
La clé ? Une culture d’entreprise bienveillante, qui valorise la coupure comme un facteur de performance, et non comme une marque de désengagement. Car au fond, valoriser la déconnexion, c’est aussi prendre soin de la santé mentale et de l’engagement durable des équipes.
Un droit à faire vivre... grâce à une meilleures organisation du temps
Le droit à la déconnexion est plus qu’un texte de loi. C’est un levier de santé mentale, de bien-être salarié… et de performance durable. Encore faut-il qu’il soit appliqué et respecté. Pour les entreprises, il est essentiel de mettre en place des outils permettant de suivre et réguler les temps de connexion.
💡 C’est là qu’une solution de gestion des temps et des activités (GTA) prend tout son sens :
- Suivi précis du temps de travail effectif
- Alertes en cas d’heures excessives
- Meilleure anticipation des congés et absences
- Encouragement d’une culture du temps sainement cadrée
Et si cet été, on prenait vraiment le temps… de se déconnecter ?